Je ne doute pas de l’idéologie alarmiste par principe. Mais je refuse l’angoisse et le matraquage apocalyptique. Alors je cherche des continuités dans l’histoire des événements météorologiques extrêmes, et j’en trouve, et j’ai des raisons sérieuses de questionner les conclusions apocalyptiques.
 Je suis loin d’être seul dans cette recherche. Je suis abonné aux publications d’Emmanuel Garnier. Il est chercheur au CNRS, professeur d’Université, indépendant du Giec. Sa spécialité est l’histoire du climat depuis 500 ans, et l’étude des catastrophes qui en résultent. Il est auteur de livres et articles sur le climat et le CO2.
Je suis loin d’être seul dans cette recherche. Je suis abonné aux publications d’Emmanuel Garnier. Il est chercheur au CNRS, professeur d’Université, indépendant du Giec. Sa spécialité est l’histoire du climat depuis 500 ans, et l’étude des catastrophes qui en résultent. Il est auteur de livres et articles sur le climat et le CO2.
L’article du jour est intitulé: « Le changement climatique entraîne-t-il plus de catastrophes ? » Il peut être lu intégralement sur ce site en page 19.
On est en plein dans le sujet. Je citerai quelques extraits importants pour illustrer son propos, qui est aussi le mien.
Emmanuel Garnier commence par faire une distinction entre évènement extrême et catastrophe naturelle.
« Le risque et la résilience sont intimement liés à la survenue de l’événement extrême. En effet, sans victimes ni dommages, il n’y a pas de « signature sociale » et donc pas de catastrophe. Ainsi, un aléa naturel (inondation, cyclone, sécheresse, etc.) majeur, s’il se produisait dans une région totalement dépeuplée, un scénario peu plausible de nos jours en raison de la pression démographique mondiale, ne serait pas une catastrophe mais seulement un événement extrême ou un aléa. »
Comme un cyclone au milieu de l’océan: s’il n’impacte personne, ce n’est pas une catastrophe. Une catastrophe inclut des pertes considérables, humaines et matérielles, avec un impact social et géographique fort. Mais monsieur Garnier veut valoriser la notion de catastrophe, porteuse de résilience.
« Ce phénomène brutal et rapide marque une rupture et engendre une modification du système concerné, voire un nouveau système qui peut paradoxalement donner naissance à un modèle plus pertinent et durable. Nous parlerons alors de capacité de résilience.
Dans ces conditions, plutôt que de s’interroger sur l’augmentation des événements extrêmes, il paraît plus judicieux d’inverser la perspective en s’intéressant à celle des catastrophes. De la sorte, c’est la mesure de la vulnérabilité qui émerge, préoccupation majeure s’il en est des assureurs et des décideurs. »
Que faisaient les anciens? Ils cultivaient la mémoire et se transmettaient les récits des catastrophes passées, pour garder une vigilance sur le présent et apprendre quelles étaient leurs failles. Or cette mémoire s’est peu à peu étiolée, effacée.
« Le paradigme de civilisation élaboré par Montesquieu affirme comme postulat que plus les sociétés sont évoluées, plus elles sont capables de se mettre à l’abri des conséquences des catastrophes.
Les archives de l’historien tendraient à prouver le contraire lorsqu’elles soulignent la capacité des communautés d’autrefois à conserver et transmettre la mémoire des risques climatiques et, au-delà, à en tirer des retours d’expérience à même d’améliorer des stratégies de résilience dont les repères visuels, les ex-voto et les paysages sont les signes les plus emblématiques. »
Il va plus loin:
« Si l’expérience du passé ne doit pas être idéalisée, elle doit en revanche être exhumée, préservée et réemployée pour concevoir des mesures de prévention basées sur les adaptations élaborées par nos devanciers. Pour eux, en effet, le risque n’était pas une fatalité mais plutôt un état d’attente débouchant sur l’anticipation d’une crise éventuelle. Ils veillaient donc à entretenir le souvenir des catastrophes passées et à se préparer à la menace permanente. »
Concrètement:
« Les communautés développèrent des systèmes d’alerte-prévention souples et efficaces permettant aux populations de se réfugier, soit à l’étage de leur maison, soit dans des zones réputées, de mémoire d’homme, insubmersibles. »
Pour quelle raison la transmission active de cette mémoire s’est-elle perdue? Selon l’auteur:
« Malheureusement, cet enseignement a été perdu en raison de la « rupture » mémorielle induite par l’exode rural, l’attraction balnéaire, la pression immobilière et le tout ingénierie, postérieurs à la Seconde Guerre mondiale. »
Ce qui a conduit à des absurdités:
« Bis repetita placent dans les Antilles françaises ! Alors que les premiers colons guadeloupéens avaient veillé à s’installer sur la côte-sous-le-vent, car moins exposée aux ouragans, les cinq dernières décennies d’aménagement foncier ont conduit à concentrer la population dans la partie est de l’île autrement dit la plus vulnérable aux vents. »
La Faute-sur-Mer n’a pas fait mieux malgré les submersions passées. La mémoire s’est déchirée:
« Ville martyre (29 décès) par excellence de la catastrophe Xynthia, la commune de La Faute-sur-Mer fut inondée à douze reprises entre 1700 et 2010, avec une accélération de ces extrêmes entre les années 1920 et 1940. La presse locale (L’Ouest-Éclair) se fait d’ailleurs largement l’écho, photographies à l’appui, des prés et champs (et non des lotissements comme aujourd’hui) sous les eaux mais ne signale que de très rares victimes. »
Il préconise d’ailleurs d’élever des stèles mémorielles:
« Ces jalons paysagers n’indiqueraient pas forcément une hauteur d’eau atteinte à un endroit donné mais au moins une indication sur la progression maximale du phénomène à plusieurs dates différentes. Sur un plan technique, les autorités veilleraient à ce qu’ils ne se limitent pas à de simples plaques « commémoratives » aux dimensions dérisoires, comme le sont les repères officiels promus depuis Xynthia (diamètre de 8 cm). Rapidement patinés, ils sont peu remarquables pour le citoyen.
Plus volumineux donc, ils devraient non seulement comporter la hauteur d’eau ou la mention de l’événement mais également indiquer la nature des dommages(humains et économiques) qui en résulta. À l’instar de l’Allemagne ou de la Grande-Bretagne, l’idéal serait de créer des ouvrages du type « stèle » d’une hauteur suffisante (2 à 3 m) et dégagés afin de constituer des rappels visuels identifiables et sanctuarisés. »
L’image 4 montre une stèle à La Chapelle sur Loire. Elle commémore la grande crue du fleuve de 1856 (gravure, image 6). La cote de 7,03 m a été atteinte. Depuis 1910 aucune cote n’a dépassé les 6 m.
Notons que cette crue de 1856 avait laissé place à un gouffre de 14 à 17 mètres, comme le glissement de terrain récent en Allemagne. La hauteur des vagues est estimée à 15 mètres. Elle faisait partie d’une série de trois crues majeures (1846, 1856, 1866) suite à deux vagues de pluies diluviennes: une crue cévenole et une crue atlantique simultanément faisant jonction sur le bassin de la Loire.
J'ai choisi de longs extraits, cela me paraissait indispensable.
Autre aspect de son article, que je ne fais que citer pour laisser intact l’intérêt de sa lecture: à part quelques exceptions, l’historien, bien documenté, ne relève pas d’accroissement significatif des épisodes extrêmes au XXe siècle ou plus récemment qui seraient dû au réchauffement.
Un passant disait à un policier, lors d’une cérémonie de mémoire à La Faute-sur-Mer: « Encore une cérémonie, ils feraient mieux d’oublier…! » Au contraire, il faut se souvenir, pour transmettre cette notion de risque et de menace permanente.
Sans mémoire nous sommes perdus, nous agissons comme des écrevisses dans l’eau bouillante, nous capitulons ou nous vouons à des chimères. Ou nous plongeons dans le drame, comme à La Faute-sur-Mer.
C’est important de le dire et d’inclure ce paramètre dans nos réflexions. La mémoire a été inversée. Elle ne repose aujourd’hui plus sur des événements climatiques passés, analysés et compris (ou non), mais sur un futur projeté que rien ne valide en l’état.
Cette option intellectuelle est régressive en ce qu’elle nous coupe de sources historiques susceptibles de nous donner confiance en nos capacités à surmonter les crises.
Rappel du lien vers l’article.
N.B.: on voit par endroit des stèles, ces monuments mémoriels, de grande taille. À La Faute-sur-Mer c’est aujourd’hui le cas (image 5, crédit Le Reporter Sablais).
À propos d’Emmanuel Garnier:
« Membre senior de l’Institut Universitaire de France et Professeur invité aux Universités de Cambridge et de Genève, Emmanuel Garnier est Directeur de Recherche au CNRS. Ses recherches sont consacrées à l’histoire des risques (naturels, militaires, climatiques, sanitaires). Elève du Professeur Emmanuel Le Roy Ladurie, il dirige ou participe à plusieurs projets de recherche français, suisses et européens du programme FP 7. Son expertise l’amène à collaborer régulièrement avec le Ministère de l’Ecologie français, des réassureurs et des modélisateurs du risque. »
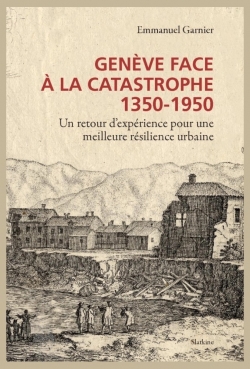
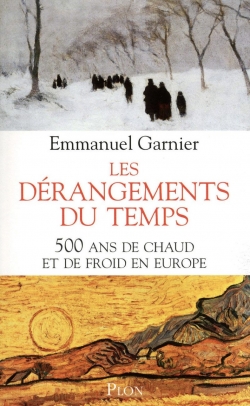



Commentaires
la fumisterie continue
https://www.largus.fr/actualite-automobile/loi-climat-zfe-confirmees-pour-2025-et-prets-a-taux-0-des-2023-10674398.html
surtout que le CO2 n'est pas un polluant !!!
https://www.caradisiac.com/vignette-crit-air-et-zone-a-faibles-emissions-pourquoi-ca-ne-marchera-pas-187850.htm